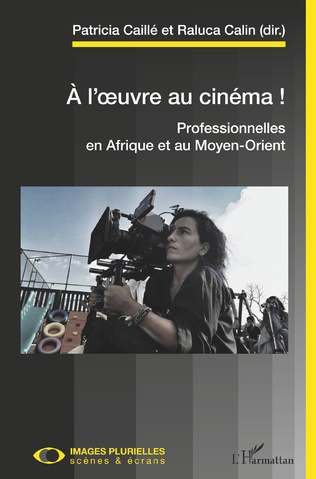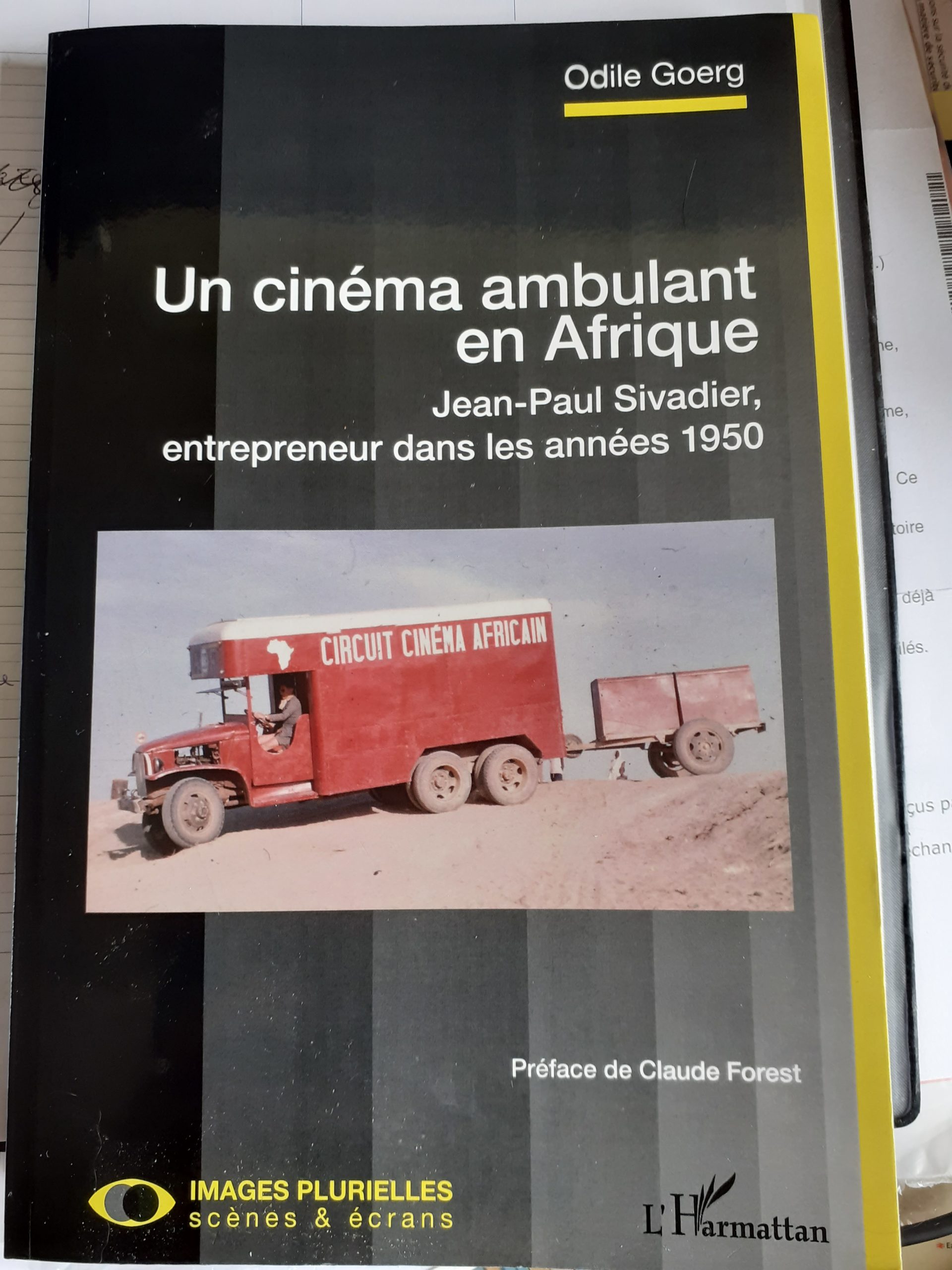Journée d’étude – le 5 mai 2023 – en visio
On note à travers le monde une augmentation très rapide du nombre de productions filmiques et audiovisuelles, la distinction entre les deux se redessinant au gré des avancées technologiques, que celles-ci touchent la production ou la circulation des œuvres. Dans le sillon tracé par le Ghana et le Nigéria, de nouvelles industries se développent au Sénégal et en Côte d’Ivoire dont des plateformes diffusent les productions à des publics locaux et régionaux très enthousiastes. Le paysage de la production devenu multipolaire impose de nouveaux rapports de force dans la circulation des œuvres.
Qu’en est-il de la formation des techniciens et techniciennes dans ces espaces? Les écoles de cinéma nées à l’orée des indépendances n’ont pas survécu. Au Sud du Sahara, l’Afrique du Sud est un des rares pays où formations universitaires et écoles sont bien implantées, mais de nouveaux programmes de formation émergent comme, par exemple, Africadoc depuis 2022, destiné au documentaire de création, ou encore l’école ouverte à Dakar en 2022 à l’initiative de Ladj Ly du collectif Kourtrajmé. Dans la région MENA, l’accès plus ou moins pérenne à la formation théorique et pratique s’est développé depuis plusieurs décennies. Et si pour les prétendants de la première génération, le passage par des grandes écoles en Europe était obligé, les producteurs aux EAU, au Liban, au Maroc, en Tunisie, etc., constituent leurs équipes en faisant largement appel à des compétences locales. En quoi l’accès local à la formation a-t-il transformé le fonctionnement des secteurs, les manières de produire, et les enjeux des industries locales ? Si la demande de production s’est fortement accrue, qu’en est-il de la formation et des conditions de travail des technicien.nes sur ces marchés ? Les manières de faire issues de ces formations et/ou des acquis de l’expérience locaux, permettent-elles de s’affranchir des préceptes, des conditions et des images imposées par les hégémonies occidentales ? Proposent-elles d’autres organisations du travail, d’autres représentations ?
Travailler dans le cinéma comme dans l’audiovisuel requiert savoirs, savoir être, et savoir-faire techniques importants, en sus de la flexibilité et des mises à niveau permanentes qui sont de mise à tous les échelons. Si beaucoup n’ont pas l’opportunité de voyager en dehors du pays, la question des visas est cruciale, nos enquêtes sur les technicien.nes menées dans le cadre du projet CREACOLCIN ont montré comment l’expérience s’acquiert souvent dans l’alternance entre des tournages locaux et des tournages étrangers. Ce qui relève le plus souvent de la nécessité représente aussi des opportunités de formation et de revenus. Nous aimerions rendre compte ici des points de tension que peuvent engendrer la circulation entre ces mondes. Comment sont aujourd’hui vécues les expériences de tournages étrangers dans les pays d’Afrique et du Moyen Orient ? Choix ou nécessité ? Quels enjeux pour les technicien.nes ? Comment y accède-t-on ? Quels sont les critères de sélection, les postes accessibles et pour quelles transmissions ? Quelles interactions, quelles fertilisations croisées, quels points d’achoppement ? Dans quelle mesure ces tournages permettent-ils aux travailleur.ses d’accroître localement leurs compétences et leur potentiel d’insertion dans les secteurs ? Que dire des rapports de pouvoir et de domination à l’œuvre dans la concurrence que se font les États des Suds pour attirer les grosses productions transnationales ? Quel est aujourd’hui le statut de telles productions dans les économies des secteurs locaux ?
Programme de la journée
9h55 : Accueil et Introduction
Patricia Caillé (Université de Strasbourg/CREM), Raluca Calin (Université de Lyon 3/MARGE & Ircav) et Lambert Ndzana (LN International)
10h15 –11h15 : Kay Dickinson (Film and TV dept., University of Glasgow)
“Greasing the Wheels of Transnational Film Production: The United Arab Emirates’ Post-Oil Vision for Education”
11h30-13h30 : Table ronde avec des professionnels
Se former localement au cinéma : quelles opportunités, quels enjeux, à quel coût ?
Intervenants : Barry Amayen (Chef élec., CM), Azza Chaabouni (ISAMM, TN), Ons Kamoun (ESAC, TN), Cringuta Pinzaru (Dir. Photo, MA), Abdel Karim Tanga (Opérateur caméra, CM), Frédéric Violeau (Chargé de programmes, DocMonde).
Modérateur.rices : Patricia Caillé et Lambert Ndzana
13h30-15h00 : PAUSE DÉJEUNER
15h-16h – Chihab El Khachab (Anthropology, University of Oxford) :
« Notes à propos de la formation cinématographique au Caire »
16h10-18h00 : Table ronde avec des professionnels
Les tournages étrangers dans le fonctionnement et l’économie des secteurs locaux : apprentissages, interactions, fertilisations croisées, tensions.
Intervenants : Kahena Attia (monteuse, TN – sous réserve), Christelle Magne (Cheffe Op., CM), Merhet Manfredo (Realness Institute, ZA), Mohamed Saïd Ouma (Documentary Africa, KE), Zenabou Pombura (Cinéaste, CM) .
Modératrices : Raluca Calin et Alejandra Val Cubero (Université Juan Carlos III, ES)
Conclusions : 18h00-18h15
Pour toute information contacter:
patricia.caille@unistra.fr ou raluca.calin@univ-lyon3.fr.
Pour participer à la journée:
Un formulaire d’enregistrement est à votre disposition: https://vu.fr/UGMY
Vous recevrez un mail avec l’ensemble des renseignements de connexion.
Comité d’organisation:
Patricia Caillé (Université de Strasbourg/CREM)
Raluca Calin (Université de Lyon 3/MARGE & Ircav)
Lambert Ndzana (LN International)
Partenaires:
Université de Lyon 3 Jean Moulin, Laboratoire Marge, Goethe Institut, Réseau HESCALE, Labex.ICCA, CREM, MSH Lorraine.
Notices biobliographiques:
Kay Dickinson works in the University of Glasgow Film and Television Studies department and is the convenor for MA Creative Arts and Industries. She is the author of Arab Cinema Travels: Transnational Syria, Palestine, Dubai and Beyond (BFI Publishing, 2016) and Arab Film and Video Manifestos: Forty-Five Years of the Moving Image Amid Revolution (Palgrave, 2018). She has published on various aspects of film production and education in peer-reviewed journals and award-winning anthologies and is currently completing a monograph entitled Supply Chain Cinema: The Transnational Production of Big-Budget Film Workers (BFI Publishing, 2024).
Chihab El Khachab est maître de conférences en anthropologie visuelle à l’Université d’Oxford. Ses travaux portent généralement sur les mass médias et la culture populaire en Égypte, particulièrement le cinéma, la télévision et les mèmes en ligne. En 2021, il publie son premier livre, Making Film in Egypt (Fabriquer les films en Égypte), aux éditions de l’Université Américaine du Caire (AUC Press). Il s’agit d’une ethnographie de l’industrie contemporaine du cinéma égyptien, portant une attention particulière au travail quotidien des professionnels du cinéma, aux processus de production locaux et aux technologies ordinaires de production. Il a également publié sur le cinéma égyptien dans un nombre de revues scientifiques comme le Journal of the Royal Anthropological Institute, Arab Studies Journal, Arab Media & Society et Visual Anthropology Review.


 CA, la MS
CA, la MS H Lorraine et le CREM
H Lorraine et le CREM